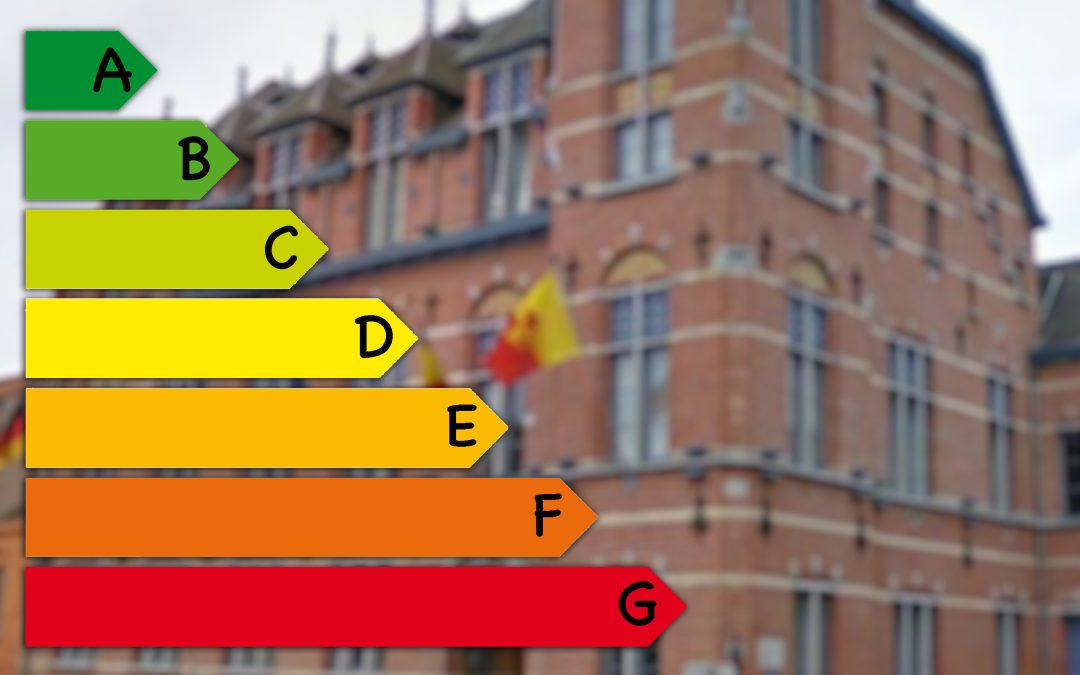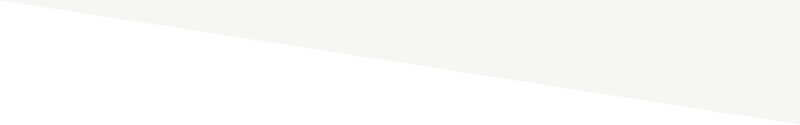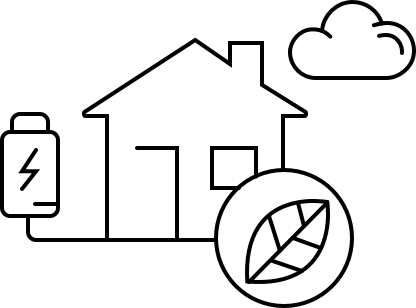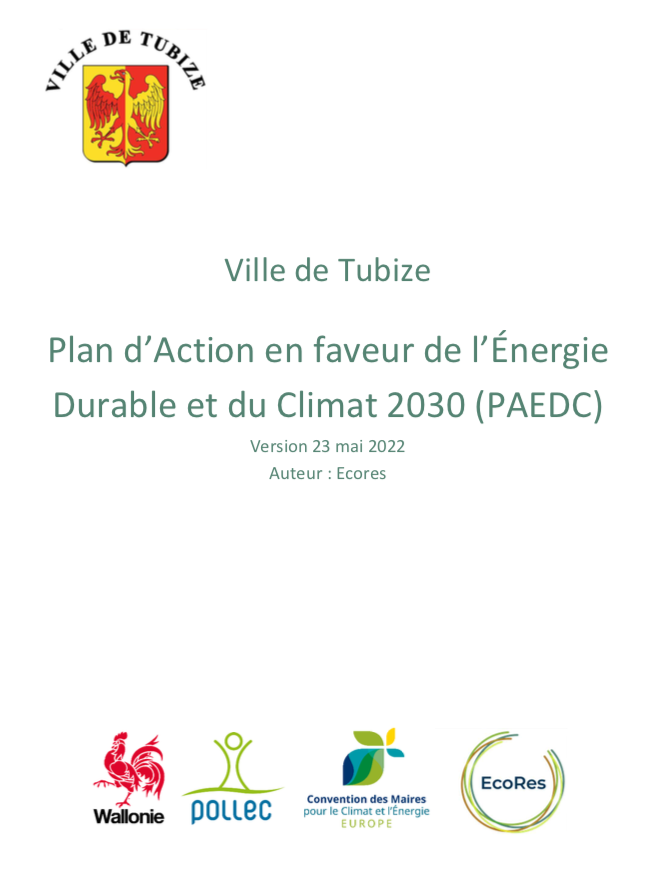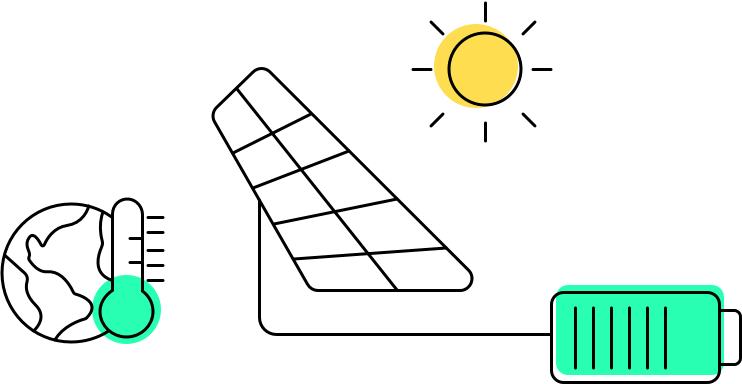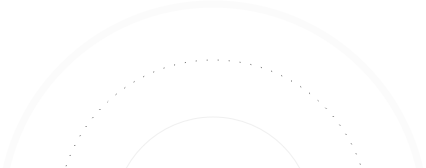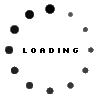Contraint de ralentir son activité pendant la crise COVID-19, l’hôpital de Tubize n’en est pas moins resté actif…
RÉNOVATIONS DE GRANDE AMPLEUR
Ces derniers mois, de lourds travaux y ont ainsi été réalisés. L’hôpital bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle entrée totalement rénovée. Non seulement, celle-ci donne une fière allure à l’hôpital, mais elle agrémente également la vue depuis l’intérieur.
Mais ce n’est pas tout… L’hôpital de Tubize a également profité de ces derniers mois pour clôturer les travaux au premier étage. L’aile ayant été totalement rénovée, l’hôpital jouit désormais d’un tout nouvel étage de consultations. Confortable, ergonomique et lumineux.

LES URGENCES DE JOUR: UN CONCEPT INNOVANT
Un concept innovant d’urgences de jour qui permet une prise en charge sans rendez-vous, 7/7 jours, de 8h30 à 20h00. Ce concept est notamment très apprécié des généralistes de la région. La relation avec ces derniers est d’ailleurs très bonne et la collaboration ne cesse de se renforcer.
Le centre de diagnostic rapide est joignable pour toute prise en charge médico-chirurgicale ne relevant pas de l’urgence vitale. Sutures de plaies, traitements de factures et entorses, bilans de pathologies,.. Le centre offre des consultations médicales fournit des soins et un bilan complet (prises de sang, radiologie, cardiologie. Dans un délai rapidement court.
La différence avec des urgences classiques c’est le temps de prise en charge et le suivi avec les médecins généralistes. En effet, lorsque vous vous présentez dans des urgences classiques, votre « tour » dépend des urgences vitales. Ici la prise en charge est directe en fonction de votre arrivée. La collaboration se fait avec les médecins généralistes des patients pour permettre un meilleur suivi.

LE CENTRE PASS@DO FÊTERA SES 3 ANS!
Parmi les projets ambitieux et novateurs développés par l’hôpital de Tubize, le centre Pass@do, situé au quatrième étage, fait office de belle réussite.
Ce centre de jour s’adresse aux adolescents en souffrance psychique, dont le fonctionnement scolaire, social et familial est entravé au quotidien. Il accueille 150 patients par an et est très apprécié dans la région. Ce type de structure manquait véritablement dans la proposition de soins en Brabant wallon.
Un réfectoire, un salon, une salle pour les activités artistiques ou sportives, un local pour pratiquer de la thérapie familiale ou de groupe.
UN CENTRE DE JOUR PSYCHIATRIQUE POUR ADULTES
Au troisième étage, un tout nouveau centre psychiatrique de jour a vu le jour. Il permet de traiter les burn out, dépression, crise d’angoisse,…
Avec la vie de groupe et des ateliers créatifs, il permet aux citoyens de reprendre confiance en eux.
UN NOUVEAU CABINET DENTAIRE
Le cabinet dentaire a la particularité d’être implanté directement au sein de l’hôpital. Cela vous permet d’accéder à toutes les infrastructures du centre hospitalier mais aussi à un très large panel de soins médicaux et paramédicaux.
Le cabinet vous propose de nombreux soins bucco-dentaires allant de la dentisterie générale à la parodontologie en passant par la pédodontie.

LE SITE DE TUBIZE PRÉFIGURE L’UNE DES FORMES DE L’HÔPITAL DE DEMAIN
UN MODE DE FONCTIONNEMENT PRÉCURSEUR
Depuis 2017, le site de Tubize a su se réinventer dans un tout nouveau concept, à savoir un hôpital exclusivement «de jour».
LE MODÈLE DE DEMAIN
L’hôpital de Tubize reflète certainement une des formes que prendra l’hôpital de demain. Son évolution en hôpital de jour est en effet tout à fait dans la lignée de l’ambulatorisation de plus en plus importante que va connaître l’offre de soins dans les années à venir!»
UNE VASTE OFFRE DE SOINS
L’offre de soins y reste extrêmement diversifiée et pointue. «Non seulement, la variété des consultations est ici très importante, mais les possibilités de réalisation d’actes médicaux (gastroscopies, colonoscopies, tests urologiques…) ou chirurgicaux (ophtalmologie, orthopédie, chirurgie de la main…) le sont également.» La technique d’imagerie est aussi bien développée, avec table de radiologie, scanner, échographie, etc. disponibles 7/7 jours.